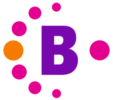Parmi les maîtres qui m’ont aidé à affiner mon regard sur le monde autour de moi, figurent deux Allemands : Max Beckmann (1884-1950) et Georg Baselitz (1938). Les deux artistes ont traduit un monde brut en œuvres d’art, ils ont capturé l’indicible. Mais si j’aborde la peinture ici, c’est pour parler éducation et numérique, bien que j’adore parler art.
Comme le monde numérique dépasse le numérique seul, voilà un texte qui aurait pu sortir de mon carnet privé. Je vous l’ai dit dans le sous-titre du blog : « le numérique et tout ce qui me passe par la tête ». Si l’on me reproche parfois de ne pas être suffisamment focalisé, je vais prendre le contrepoint, radicalement.
De la peinture dans le monde
Baselitz était, au temps de mes années passées aux Beaux-Arts, considéré comme un artiste influent, mais à contre-courant des tendances à la mode, c’est-à-dire, l’art abstrait. Si Beckmann positionne ses personnages plutôt dans un monde intérieur, Baselitz les met dans la nature : les formes et contre-formes ne sont pas les mêmes, mais témoignent dans les deux cas de forces vives entre les sujets et leur entourage. Autre point commun : les deux peintres emploient une signature expressionniste, avec de vifs traits et couleurs, signe d’un monde mouvementé et brut. Mais si Beckmann peint ses sujets grands (comme s’ils voulaient sortir du cadre) et avec des contre-formes très distinctes, Baselitz les met invariablement dans un espace la tête en bas, les pieds en haut, et ce, depuis des décennies. C’est le monde à l’envers.
Dans un très bel article dans Le Monde du 25 janvier (2018) sur Baselitz, il y a une citation très forte : « C’est mon Sonderweg — il me faut aller contre ce qui existe — et donc ne m’intéresse pas — pour aller vers ce qui n’existe pas encore. » Ils continuent à m’inspirer, non en dernier lieu par la matérialité de leur peinture.

http://wertical.com/daily-2/georg-baselitz-2/
Peindre est une activité de fortes passions qui nécessite un ancrage de soi important. Ce que l’on met sur un support, aussi bien en matière de matérialité qu’en termes symboliques, ne plaît pas toujours à l’auteur et nécessite, la plupart du temps, un travail de boucle proximité-recul-distance qui ne s’arrête jamais. Une des manières de s’obliger à prendre de la distance, c’est de tourner l’œuvre à l’envers : il y a une forme d’aliénation de l’objet, dont on se forme une idée dans sa tête, ce qui permet de juger avec un recul nécessaire ce qui est, pour autant que c’est possible de se distancier de ce que l’on pense ce qui est.
Tourner le monde à l’envers, à quoi bon ?
Il y a quelques jours, dans l’article sur la nécessaire éducation au numérique, je mentionnais que la problématique ne se trouve pas toujours là où on l’imagine, par exemple parce qu’on ne l’identifie pas correctement. Ce que n’ait pas encore écrit, c’est que l’identification de la problématique mène presque invariablement à la destruction de ce que l’on aime, car ce que l’on aime peut cacher le vrai, et la détruire peut donner l’espace nécessaire pour révéler ce qui est important. Voilà pourquoi peindre est un métier douloureux : pour créer à partir de rien quelque chose de plus grand, plutôt qu’une belle chose, il faut se surpasser et être prêt à rencontrer l’inconnu, ce qui n’existe pas encore — mais sans la certitude que le nouveau dépasse l’ancien.
Ne serait-il pas possible qu’en matière de l’éducation au numérique, aussi bien dans l’apprentissage formel qu’informel, on se trompe de la problématique ?
Que nous inventions des solutions qui ne fonctionnent pas parce qu’elles ne changent pas les parties du tableau qui souffrent réellement, parce que nous les trouvons trop belles pour les détruire ? [1]
Les uns proposent de limiter le temps qu’un jeune peut passer devant l’écran, les autres interdisent les téléphones portables à l’école. Les uns disent que les élèves ne savent plus écrire et que leur écriture même souffre par le numérique, les autres disent qu’ils ne peuvent plus se concentrer. Et entretemps, les statistiques et enquêtes sur le cyberharcèlement sortent et hopla ! on recommence. La suite est remarquablement stable : on va expliquer aux jeunes comment il faut se comporter en ligne, les dangers qu’ils encourent et qu’ils causent, avec la certitude qu’eux, ils n’en comprennent rien et que nous, tout.
Tournons le monde à l’envers et voyons ce qui en sortira
Mais voilà, toutes ces bonnes mesures, prise avec de bonne foi, ne mènent pas à des résultats : on doit constater que l’efficience des chartes, règles, interdictions, limitations et j’en passe, n’est pas impressionnante. Il est peut-être temps de changer le fusil de l’épaule, de tourner le tableau à l’envers et de voir où exactement se trouve la problématique, quels en sont les contours, avant de lui accorder un nom — ou inventer une solution.
Je parie que nous trouverons quelque chose de tout à fait différent. [2]
Je vais ici émettre quelques hypothèses sur le système scolaire :
- Est-ce que le système scolaire permet de se concentrer, sur soi, sur un sujet ? Est-ce qu’il n’émet pas trop de bruit ?
- Est-ce qu’il distingue le commun du singulier ou est-ce qu’il mène à ce que les individus se fondent dans le groupe ?
- Est-ce qu’il favorise la diversité productive, et non une diversité destructive ?
- Est-ce qu’il œuvre pour que chacun puisse développer une conscience du soi ?
- Est-ce que le système scolaire apprend à collaborer aux apprenants et aux enseignants ?
- Est-ce qu’il permet de prendre en considération l’autrui par l’empathie (et non uniquement par des règles) ?
- Est-ce que le système scolaire est fait de manière à pouvoir transformer l’enseignement en apprentissage transversal, en prenant en compte la diversité du groupe et des situations individuelles (c’est-à-dire, est-ce qu’il peut trouver les ressources dans la diversité, au lieu de les trouver uniquement dans l’uniformité) ?
- Est-ce que le système scolaire arrive à connecter le monde extérieur au monde de l’apprentissage ?
Je dis bien « le système scolaire », car je sais que beaucoup d’individus militent pour changer celui-ci ; si la réponse aux questions est probablement négative dans la plupart des cas, ce n’est pas « la faute aux individus », mais une problématique qui dépasse le périmètre des seuls individus.
On entend rarement les adultes s’imaginer comment ils peuvent favoriser la solitude, le retrait, l’introspection pour leurs enfants ou élèves.
On apprend pas forcément l’écoute active et l’empathie.
Il est difficile pour un jeune de s’imaginer différent ET avoir sa place dans un groupe, tant la société favorise le semblable, le commun.
Certes, j’entends formateurs et enseignants dire entre eux qu’ils apprennent beaucoup de leurs élèves, mais rares sont les situations où l’élève peut prendre, si ce n’est-ce que pour un court moment, le rôle du maître — parce qu’il maitrise quelque chose que son maître ne maitrise pas (encore).
On peut être très puissant dans une posture d’humilité, mais cela ne correspond pas forcément à notre culture.
Si la solution du « problème numérique » n’était pas le numérique ?
Quand on suppose que le problème numérique est de l’ordre numérique, on cherche la solution pour ce problème dans un solutionnisme technologique : à la fois, on cherche à intégrer le numérique dans les méthodes d’enseignement, et à la fois on pense trouver une solution dans l’abstention, la règlementation ou la limitation « des écrans » (qui peuvent soulager à court terme, d’ailleurs !).
Mais supposons que le problème se situe ailleurs ? Avons-nous suffisamment tourné nos œuvres à l’envers pour pouvoir confirmer la nature de notre problématique ?
Est-ce que les clés pour résoudre les problèmes définis ci-dessus ne se situent pas surtout dans une autre approche de ce qui nous construit, ce qui nous prépare à l’avenir ? Est-ce que ce « problème numérique » n’est pas avant tout une problématique fondamentalement humaine ?
Allez, je vous dis de quoi je rêve :
- Juste pour le contexte : il y a une matière pour laquelle j’ai obtenu un diplôme (Master – cinq ans de beaux-arts). J’ai enseigné, pendant environ 8 ans, le dessin et la peinture aux amateurs allant de 6 à 75 ans. C’est donc la seule matière sur laquelle j’ose vraiment émettre une critique de professionnelle. Et je ne reviens toujours pas des dernières instructions en arts plastiques dans la classe de 4e de ma fille : « L’écart entre le référent et le signifié est constructif » (ouioui, je suis sérieuse !) ou encore : « Fragment d’un dessin de Reiser. Dessinez l’abri antinucléaire creusé et aménagé par l’un des personnages de la scène ». Le dessin comme construction cognitive, abstraite, réduit à une matérialité limitée et dans lequel l’émotion ne trouvera jamais sa place.Je plaide donc pour une éducation artistique qui fait redécouvrir la matière, le réel, le contact même avec l’objet et qui oblige à faire ce travail de traduction d’un objet matériel en un objet imaginé, mais pas abstrait.
Achetons des chevalets et faisons dessiner les élèves des natures mortes (géantes) ! Sérieux, je l’ai fait faire aux jeunes pendant des années, c’est fun. C’est excellent pour favoriser la motricité, autrefois apprise par l’écriture. Plus tard, on peut sortir avec eux et aller faire du dessin dans les rues ou dans les entourages naturels de l’école (urban sketching). Les avantages sont nombreux :- Debout devant un chevalet, le jeune est mis dans une posture active, doit apprendre à gérer son espace et sa relation au papier et à ses limites (pas facile !), doit s’entraîner dans la tenue du fusain ou du crayon.
- Le jeune doit observer, et traduire ce qu’il voit.
- Il développe une signature, une manière de s’exprimer : vous allez voir que l’écriture en profitera !
- Il « touche » réellement à une matérialité — celle de l’objet et celle du papier/crayon, dans un monde qui semble complètement dématérialisé. Dessiner un objet, c’est rentrer dedans, c’est une vraie confrontation.
- Le dessin est le meilleur moyen d’apprendre à apprécier la diversité. Quand on regarde le travail fait par tous, on s’aperçoit qu’il n’existe pas une « réalité », mais que c’est une interprétation et que chaque interprétation a une valeur significative.
- Les jeunes peuvent en profiter pour prendre en photo les dessins, les objets qu’ils dessinent, les autres dessinateurs, eux-mêmes en mode selfie avec leur œuvre, des objets connectés aux objets mis en place,…
- Parce que quand on s’attaque au Urban Sketching, la dimension d’une communauté apparaît, ainsi que le partage — les deux nécessitent des compétences sociales et techniques.
- Il apprend surtout à ne pas vouloir faire ce qu’il aimerait faire, mais doit apprendre à aimer ce qu’il sait faire.
- Pour apprendre le bien-être avec soi, j’aurai préféré de voir mes enfants faire non seulement des activités sportives avec la course au plus fort, au plus rapide pour aller à la victoire. Pourquoi ne danse-t-on pas à l’école, ou pourquoi n’exerce-t-on pas le yoga, la méditation, Pilates ou les arts martiaux ?
La danse : apprentissage d’une autre motricité, très corporelle aussi, qui nécessite technique, concentration et rigueur, dépendant de quel type de danse évidemment ; mise en relation du corps avec la musique ; excellente approche pour un rééquilibrage entre les sphères traditionnellement masculines et féminines ; confrontation avec différents styles de musique (lier ces apprentissages à l’histoire, cultures, langues…) ; mise en chorégraphie pour apprendre à jouer le collectif, tout en pouvant mettre en avant les différents talents…
Le yoga, la méditation, Pilates : concentration sur soi, bien vivre le vide et l’absence des signaux extérieurs, vivre la vulnérabilité comme une puissance, et cetera.
- Pour favoriser la culture générale, je propose qu’on crée des espaces d’apprentissage où il se trouvent obligatoirement des bibliothèques, avec des livres sur la matière, mais également sur des sujets connexes. On nous dit que nos jeunes ne lisent plus, mais qui a encore une bibliothèque dans son séjour pour donner ce goût de découverte à ses enfants ?
Si on valorisait cette culture de la recherche physique, de la curiosité à travers des objets physiques, on devrait, dès le primaire, proposer des objets de lecture partout et non seulement dans les CDI. L’objet livre devrait faire partie du quotidien de l’apprenant.
Mais avec la bibliothèque, on aura aussi besoin de temps entre les cours : le temps pour un élève de se rapprocher d’un enseignant, de choisir un objet livre, et pour l’enseignant de transférer une autre dimension de sa passion. Nous avons institutionnalisé le partage et nous exprimons du mépris pour le partage entre jeunes, alors que celui-ci dévoile souvent de vraies passions. Le lieu de l’apprentissage devrait redevenir un lieu de labo, de partage, et ce, pour favoriser l’attention, la concentration, la passion, la curiosité.
Ce sont juste quelques exemples de mon système scolaire rêvé, parce qu’« il me faut aller contre ce qui existe — pour aller vers ce qui n’existe pas encore », un peu comme ça.
Les acteurs du monde à l’envers
Il existe des laboratoires dans le monde de l’enseignement et de l’éducation populaire dans lesquels on œuvre pour un futur dans lequel le numérique fera part des approches et des outils. J’ai été intervenante, il y a quelques années, de l’EducPop2.0 (lisez ce rapport sur les dix ans d’expériences en la matière !), à Pau il y a mon ami Jean-François Ceci qui est spécialiste du numérique à l’école et à Bruxelles il y a un « Laboratoire de la classe de demain », où sont testés les effets d’une autre spatialité sur les usages. Ce dernier est le fruit d’une collaboration internationale, qui se poursuit au niveau national en France depuis 2015, notamment avec des partenaires dans la région de Poitiers.
Juste au moment d’écriture de mon article, par lequel j’ai voulu coucher mes idées sur support numérique, pour les garder et y revenir, (car le blog, c’est aussi mon carnet de notes partagées avec vous), je suis tombée sur cette petite vidéo, qui est intéressant parce qu’elle parle des valeurs et du rôle et de la posture de l’enseignant.
PS – Et si l’« Urban sketching », le dessin en milieu urbain vous tente, n’hésitez pas à contacter mon ami Michel Croctoo, ancien architecte qui a tourné son monde à l’envers pour une deuxième carrière et qui est un excellent maître en la matière !
[1] Et que ceci est partiellement le cas parce que, même avant qu’on échoue peut-être, il faut déjà rendre des comptes… sans avoir eu le temps de tester. Le système est lourd, puisque grand, et construit d’innombrables interdépendances : il est impossible de le changer en une seule fois. Au lieu de crier scandale, acceptons que le changement ressemble beaucoup au développement des technologies sous-jacentes : deux pas en avant, un pas en arrière, et parfois même deux pas en arrière. Pour accepter le changement, il faut croire en un temps long.
[2] Disclaimer : je parle ici pour le grand pourcentage de personnes impliquées qui ne sont pas atteintes de graves dysfonctionnements, de perturbations et de comportements véritablement asociaux. Ce que je propose doit être lu et interprété pour la plupart de nous, des gens normaux, qui ne souffrent pas nous-mêmes — et ne font pas souffrir leurs proches — par des maladies et dysfonctionnements qui relèvent de la psychiatrie ou de l’aide professionnelle.